Le processus cartographique en Révolution : le port de Boston et l’intervention française de 1776
Les cartes existent sous plusieurs formes dont la version imprimée constitue l’aspect le plus commun et familier pour nous. Sa taille générale et son aspect ont peu changé depuis le XVe siècle lorsqu’elle fit son entrée sur le marché européen et devint rapidement une partie du vocabulaire visuel de la culture européenne. Les cartes apparurent sur les murs des espaces publics et privés, dans les livres, les revues, comme des œuvres imprimées. Au XVIIIe siècle, les cartes imprimées étaient achetées et utilisées non seulement par une élite mais par un public d’amateurs de plus en plus large. Les cartes imprimées requéraient un réseau élaboré d’ouvriers qualifiés et de ressources naturelles, de graveurs, d’imprimeurs, de plaques de cuivre, de papier, d’encre, de presses à imprimer et enfin, très important, un marché pour diffuser ces cartes dans le public. La carte imprimée répandait de l’information, quelquefois vraie, quelquefois imaginaire, et reflétait le goût des consommateurs et les variables économiques affectant leur production.
Le commerce européen des cartes imprimées du XVIe au XIXe siècle devait sa qualité internationale spécifique à un petit groupe de travailleurs spécialisés, particulièrement des graveurs sur bois et en taille-douce. Cette main d’œuvre fluide franchissait fréquemment les frontières, spécialement pendant les bouleversements du XVIIe siècle. Les guerres de Religion et la Guerre civile en France et en Angleterre poussèrent les graveurs, qui étaient souvent protestants, à franchir les frontières. Cherchant la sécurité et un emploi stable, ils se rendaient dans les capitales de l’imprimé en France, en Angleterre et en Hollande. La carte imprimée, produit de leur travail, franchissait aussi ces frontières, et les cartes étaient ainsi régulièrement importées d’un pays à un autre à travers l’Europe1.
Cartes et sciences
Le commerce de la carte imprimée était aussi international que le commerce de l’information géographique. Un nouveau modèle de pensée scientifique s’était imposé au cours du XVIIe siècle : l’idée que les « faits » étaient vérifiables par une observation et des mesures répétées. Le raffinement des lentilles grossissantes utilisées dans le télescope (et dans le microscope) permettait de voir des objets distants avec une plus grande netteté et précision qu’auparavant. En outre, les observations pouvaient être refaites n’importe où, par n’importe qui. Ces développements encourageaient les idées nouvelles sur la place de la terre par rapport au soleil et aux autres planètes (système copernicien ou héliocentrique) et sur la gravitation et ses effets sur la forme de la terre elle-même. Tour à tour, ces idées encourageaient les efforts nationaux accomplis dans la mesure de l’espace géographique et l’utilisation des cartes pour visualiser et résoudre des problèmes scientifiques et administratifs.
La fondation à Londres de la Royal Society en 1660 (confirmée par charte royale en 1662) et à Paris de l’Académie royale des sciences en 1666 créa deux centres pour le débat et la recherche scientifiques et pour l’exploration géographique tout au long du XVIIIe siècle. Ces capitales étaient également le siège d’actifs centres du commerce cartographique dans la mesure où le rôle de la science (observation, mesure, vérification) devint de plus en plus important pour asseoir l’autorité d’une carte.
Le coût d’une carte

L’un des plus gros chapitres de dépenses était celui du relevé, première étape dans la chaîne de production d’une carte. Les coûts incluaient des rémunérations (salaires des arpenteurs, de leurs assistants, domestiques et guides), des instruments, des moyens de transport, des animaux (chevaux et mules), sans compter la nourriture et le fourrage. Les archives livrent des indications de coûts. Par exemple, en 1721, on estime à 12 000 livres annuelles le relevé de la Bretagne2. En 1734, le prévôt des marchands Etienne Turgot et les marchands de la ville de Paris payèrent 10 000 livres à Louis Bretez pour le relevé et la préparation du fameux Plan de la ville de Paris3. Dans les années 1750, le devis pour le relevé du royaume par Cassini était estimé à 40 000 livres annuelles, chiffre qui doubla dix ans plus tard4.
Le temps, l’argent et l’effort dépensés pour le relevé ne produisaient pas une carte prête pour la publication. Les données issues du relevé et les brouillons de cartes devaient encore être réduits sur une échelle uniforme dans une projection appropriée. Afin de réaliser les calculs mathématiques compliqués de cette étape, les cartographes employaient des assistants, étudiants ou apprentis, pour résoudre les longues équations. Encore du temps et de l’argent. Un géographe demandait plus de 2 100 livres pour ses trois assistants qui avaient mis trois mois pour preparer une carte de la Méditerranée en trois feuilles5. Pour le Plan de la ville de Paris de Bretez et Turgot, l’assistant de Bretez, M. Saury, demanda 1 200 livres pour aider à préparer le manuscrit destiné à la gravure, ce qui prit trois ans6.
Ce travail lent, soigneux, produisait finalement un manuscrit qui pouvait soit être gravé en vue de son impression soit demeurer manuscrit pour être copié manuellement. Si la carte était gravée et imprimée, elle était sujette aux mêmes dépenses en temps et en matériaux que ce qu’on trouvait sur le marché de l’imprimé: plaques de cuivre, gravure, papier, encre, impression proprement dite7. Les relevés et la préparation des cartes représentaient une dépense tellement importante dans la production cartographique que l’un des moyens pour le cartographe de réduire ses dépenses était de copier les cartes d’un autre.
Copier les cartes
Les cartes imprimées préparées pour le marché du dix-huitième siècle affrontaient une rude compétition. Ayant perdu leur caractère d’extrême cherté et rareté, les cartes se présentaient sous différents formats et à des prix abordables. Afin de séduire le marché, elles essayer d’incarner les nouveaux standards de la science, vantant leur réalisation fondée sur des relevés soignés et effectués sur le terrain avec des mesures précises. Elles offraient les attraits esthétiques d’une gravure fine, de la lisibilité et de la clarté. En raison des coûts élevés exigés par la création de nouvelles cartes, beaucoup d’éditeurs de cartes copiaient des cartes anciennes et changeaient les titres, ajoutant des expressions telles que « assujettie aux observations astronomiques ». Ou bien ils copiaient de nouvelles cartes d’autres pays, en les traduisant dans la langue du marché local.
Mais peu de cartes étaient de simples copies. En étudiant les modifications, additions et soustractions faites par le copiste, nous pouvons en apprendre beaucoup sur la réception (ou même le succès) de la carte et le pouvoir de son intention graphique. Ce qui semble être une copie peut être une carte qui délivre un message entièrement différent. Lorsque des conflits interviennent entre des États pour le contrôle d’un espace géographique, les cartes peuvent jouer un rôle important. Lorsqu’un mouvement social se joint à cette lutte, la question de la révolution prend également place dans le processus cartographique. Les cartes anglaises de l’Amérique du Nord réalisées avant et pendant la Guerre d’indépendance constituent un bon choix pour de telles études. Le gouvernement anglais à Londres se fiait aux ingénieurs militaires et civils, quelquefois étrangers, pour son information géographique sur leurs colonies éloignées. Lorsqu’elles étaient imprimées, les cartes présentaient une image coloniale de l’Amérique du Nord, un thème largement étudié du point de vue anglais8. On a porté moins d’attention à la manière dont le reste de l’Europe a ainsi visionné ces événements révolutionnaires.

Boston
Nous avons l’avantage, au XXIe siècle, de voir les événements de Boston dans les années 1770 comme l’étincelle qui enflamma le grand incendie de la Révolution américaine. Pour un Européen qui regardait l’Amérique du Nord en 1775 et au début de 1776 (avant la déclaration d’indépendance américaine de juillet 1776), la route qui s’ouvrait devant l’Angleterre et ses colonies n’était pas clairement balisée. Après le combat conduit côte à côte contre les Français en Amérique du Nord durant la guerre de Sept Ans, les tensions entre la mère patrie et les colons de Nouvelle-Angleterre commencèrent à croître fortement, car les dettes de la guerre devaient être payées. Devant l’augmentation des taxes, les colons protestèrent contre leur absence de représentation à Londres. Leur frustration éclata au cours de plusieurs célèbres événements qui furent enregistrés graphiquement dans des imprimés et des cartes contemporains.
À l’instar d’un photo-journaliste de notre époque, ce qu’on a appelé le Massacre de Boston de 1770 (5 mars) a été rendu célèbre par un imprimé gravé par Paul Revere. Ce malheureux événement avait été causé par un petit groupe d’écoliers Bostoniens qui avaient insulté dix soldats britanniques, les défiant de tirer. Les soldats en blessèrent 11 et en tuèrent 5. Les répercussions furent énormes.
Trois ans plus tard, Boston souffrit de davantage de troubles lorsque les colons rebelles, déguisés en indigènes, arraisonnèrent des navires anglais dans le port et jetèrent leurs cargaisons de thé par-dessus bord pour protester contre la taxe sur le thé. En représailles, les autorités anglaises fermèrent le port jusqu’à ce que la ville payât pour le thé perdu. Lorsque les Britanniques essayèrent d’imposer un contrôle plus étroit sur leurs sujets récalcitrants, les colons, particulièrement ceux du Massachusetts puritain, protestèrent encore plus.
Les cartes aussi documentaient les troubles coloniaux. En avril 1775, le gouverneur britannique du Massachusetts, le général Thomas Gage, envoya des troupes (700 hommes) de l’ouest de Boston vers les petites villes de Lexington et de Concord pour y saisir des armes et de la poudre que les colons avaient rassemblées. Les soldats anglais rencontrèrent la milice des colons sur le pré communal. Un coup de feu fut tiré et une escarmouche s’ensuivit. Lorsque les soldats anglais firent retraite vers Boston, un nombre toujours plus grand de milices des colons les poursuivit jusqu’au port de la ville. Le siège de Boston commençait.



Les Anglais essayèrent de forcer le siège et de contre-attaquer deux mois plus tard, en juin, en lançant l’assaut contre Breed’s Hill (actuellement Bunker Hill ) au nord de Boston. La victoire anglaise était une victoire à la Pyrrhus car ils avaient essuyé de lourdes pertes. Charlestown, au pied de la colline, avait été incendiée.
Après que les Britanniques eurent à nouveau fait retraite à leur camp de Boston, il subirent de la part des forces américaines un siège de huit mois jusqu’en mars 1776. Puis, épuisés, n’ayant pas reçu de renforts, il se replièrent au Canada (Halifax, Nouvelle-Écosse) avant de de déplacer leur quartier général au sud dans la colonie plus accueillante de New York.
Plusieurs cartes furent publiées à Londres très peu de temps après ces événements. Elles dépeignaient la marche depuis Lexington et Concord, la contre-attaque anglaise lors de la bataille de Bunker Hille et l’incendie de Charlestown. Ces cartes étaient publiées à Londres par des cartographes qui n’avaient pas quitté leur atelier. Aucun d’entre eux n’avait visité l’Amérique du Nord ; il n’est même pas certain que l’un d’entre eux ait jamais quitté Londres. Ils ne pouvaient prétendre avoir été eux-même sur le terrain. Malgré tout, l’autorité de leur produit en tant que « bonnes cartes » reposait sur leurs sources : des observations faites par des témoins oculaires. Le titre de Da Costa portait l’expression « d’après un levé recent », celui de Sayer et Bennett « Le foyer de la guerre en Nouvelle-Angleterre par un volontaire américain, »
Muni de ces certificats d’authenticité et d’autorité, les cartes furent mises en vente. Sans être bon marché, elles étaient abordables, depuis un ou deux shillings ou une demi-couronne (deux shillings et six pence : un peu moins de deux livres), soit le même prix qu’un roman ou un panier de pommes.9
Elles étaient également disponibles sur le marché international. Le catalogue de Sayer et Bennett de 1775 signalait leur boutique comme un endroit « où des gentilshommes de commerce [c’est-à-dire des marchands pratiquant l’import-export] et des boutiquiers détaillants, pouvaient trouver un vaste assortiment, à des conditions très raisonnables »10.
Les cartes de ce type permirent à d’autres cartographes européens de créer leur propre version du conflit11.
Une autre carte de Boston apparut sur le marché londonien à cette époque : la “Carte du port de Boston avec des remarques nautiques” de John Frederick Wallet Des Barres.


Des Barres avait vécu en Amérique du Nod et sa carte était certainement réalisée à partir d’observations faites sur le terrain. John Frederick Wallet Des Barres incarnait lui-même la figure internationale du commerce cartographique. Issu d’une famille de huguenots français, il avait grandi en Suisse où il reçut une éducation mathématique chez les Bernoullis. Il émigra en Angleterre et entra à l’Académie royale militaire de Woolwich vers le milieu du siècle (1752 ou 1753)12. Lors du déclenchement de la guerre de Sept Ans, il rejoignit le Régiment royal américain (60e d’infanterie) de l’armée anglaise qui avait été créé pour appuyer les ingénieurs destinés à dessiner et à construire des forts en Amérique du Nord13. À la fin de la guerre, l’Amirauté britannique chargea Des Barres de faire le relevé de la côte est de l’Amérique du Nord, de l’embouchure du Saint-Laurent à la côte de Floride. Cette énorme entreprise fut par la suite publiée dans The Atlantic Neptune.
Des Barres retourna en Angleterre en 1774 afin de préparer ces dessins pour la gravure. En mai 1775, il demanda à l’Amirauté la permission de consulter des relevés manuscrits conservés dans les bureaux de l’Amirauté pour réviser ses propres dessins. La « Map of the port of Boston with Nautical Remarks» reposait sur des relevés effectués par George Callendar en 1769 et dessinés à une large échelle (1 :25 000e) en deux feuilles de 72 x 52,5 cm, ce en qui en faisait l’une des cartes les plus soignées alors disponibles de la région. Sa diffusion ne fut pas limitée à l’Amirauté ; elle était vendue 5 shillings (environ 5 livres) pour ses grandes deux feuilles.
En dépit de l’absence d’éléments narratifs rencontrés dans les cartes précédentes de Boston, elle livre une peinture théâtrale de la topographie de la région par l’utilisation de techniques de gravure variées pour restituer les éléments du paysage. Au départ, la carte devait servir de carte nautique. Les chiffres gravés dans la mer représentent la profondeur des eaux, information indispensable pour les navires. La rose des vents délimitait les lignes de rhumb ce qui servait au pilote ou au capitaine à établir sa route.
La carte jouait également le rôle de reconnaissance militaire. La position des canons et des redoutes anglais installés autour du port traduisait la réponse britannique aux incidents des cinq années précédentes :ils étaient désignés par les lettres a à p.


Le commerce cartographique entre Londres et Paris
Bien que la carte de Des Barres ait été publiée sous l’égide de l’Amirauté britannique, elle était disponible à Paris. Le commerce des cartes entre Londres et Paris était encouragé par les graveurs huguenot d’origine française et par les imprimeurs de Londres qui conservaient des liens commerciaux avec leurs collègues de Paris. Deux cartographes-graveurs de renom, d’origine française, voyageaient régulièrement en France et importaient des cartes françaises : John (Jean) Roque et Andrew (André) Dury. Leur voisin et collègue cartographe-graveur Thomas Jefferys, géographe du prince de Galles, le futur Georges III, visita également la capitale française14. Tous trois avaient en commun un partenaire commercial à Paris : Roch-Joseph Julien, ingénieur géographe du roi and intendant des bâtiments du prince de Soubise. Julien se servait de l’hôtel de Soubise comme d’un magasin cartographique où il vendait des cartes françaises et importées15.
Julien était également en correspondance avec l’un de nos cartographes de Boston, William Faden (1749-1836). En 1775, Faden, âgé de vingt-six ans, venait d’achever son apprentissage et d’acheter une partie du stock de Thomas Jefferys16. Il développa son commerce en correspondant avec de nombreux imprimeurs et vendeurs de cartes du continent.
Sa correspondance contient de nombreuses lettres de Julien et de l’un de ses assistants, Ambroise Verrier qui lui demandaient des cartes de Londres. Le 27 octobre 1775, Verrier demandait à Faden quatre exemplaires de la « Carte du port de Boston avec des remarques natuiques par J.F.W. des Barres à Londres, que vous avés publiée tout recemment »17.
La situation instable de Boston suscitait beaucoup d’intérêt en France. La France venait d’abandonner aux Anglais ses possessions en Amérique du Nord à la fin de la guerre de Sept Ans en vertu du Traité de Paris de 1763. La guerre avait laissé à la France une dette énorme, une flotte brisée et un avenir incertain sur son influence dans le monde. Le traité avait également laissé au Québec une population francophone et catholique sous administration anglaise. La France conservait deux îles sucrières dans les Antilles (Guadeloupe et Martinique) ainsi que deux îles pour la pêche à la morue dans le Golfe du Saint-Laurent (Saint-Pierre et Miquelon). Les événements de 1775 pouvaient présager d’une restauration de la présence française en Amérique du Nord et une véritable « américano-mania » s s’empara de la capitale française : « L’Amérique était à la mode »18.

Dans cette atmosphère d’excitation, une autre carte de Boston fut encore publiée. Mais cette fois, elle parut à Paris en 1776 : intitulée Carte du Port et Havre de Boston, elle était l’œuvre de « chevalier Jean de Beaurain ».
Au premier aspect, la Carte du Port et Havre de Boston semblait une copie de la feuille gauche ou ouest de la carte de Des Barres, reprenant une topographie et une hydrographie similaires, à la même échelle de 1 :25 000e, aux mêmes dimensions (57,3 x 70 cm). Beaurain reproduisait les côtes, les collines et les rivières du Massachusetts continental ainsi que les emplacements militaires des canons et des redoutes. Il traduisait la plupart des « references » de Des Barres en « renvois » et y ajoutait un cartouche décoratif.19
Toutefois, une étude plus attentive montre que Beaurain n’avait copié la carte de Des Barres que pour quelques informations topographiques ou nautiques. Tout comme Des Barres, il utilisait un système de lettres portées sur la carte et explicitées dans les renvois figurant au bas. Mais il avait ajouté des événements sur sa carte : la bataille de Bunker Hille (H) et l’incendie de Charlestown (I), ainsi que les campements anglais cernés par les américains dans la péninsule de Boston.

Beaurain montrait les positions des troupes américaines (en rouge) et anglaises (en bleu), démontrant l’efficacité du siège des colons qui coupait les vivres aux Anglais dans le pays. La description par Beaurain du premier, deuxième et troisième corps d’Américains encerclant les Anglais était une originalité de cette carte, parmi toutes celles qui avaient été produites durant les deux ans du siège20 et l’on peut se demander d’où provenait cette information. La légende des couleurs était donnée dans les renvois au bas de la carte, accentuant l’importance de cet élément de la carte. Les positions militaires, telles qu’elles étaient figurées, donnaient l’impression que les Américains l’avaient emporté en nombre et en tactique sur les Anglais, ce qui était largement exagéré par rapport à la situation réelle sur le terrain de Boston21.

Beaurain assit l’autorité de sa carte de diverses manières. Il donnait dans les « renvois » les coordonnées de Boston, calculées astronomiquement : 42° 22' de latitude nord, 71° 4' de longitude, en utilisant le méridien de Greenwich, comme sur la carte de Des Barres. Les sondages des profondeurs du port reflétait des mesures récentes, tout comme la topographie particulièrement complexe et détaillée du rivage environnant. Les routes étaient soigneusement désignées et les boucles et coudes des rivières donnaient l’impression d’avaoir été soigneusement relevés. Les plans de Boston, de Charlestown (en ruines), de Cambridge, Roxbury et Dorchester étaient représentées par des blocs hachurés, non par des dessins figurés, ce qui était une manière typique de figurer les plans de ville au XVIIIe siècle où l’on était plus intéressé par les dimensions de l’espace urbain.
Afin d’assurer davantage encore la crédibilité de sa carte, Beaurain citait ses sources au pied de la carte : "Cette carte a été copié sur le plan original apporté à la cour d'Angleterre et levé par ordre du gouvernement. Le Chevalier de Beaurain la tient d'une personne de distinction. » La phrase « levé par ordre du gouvernement » fait allusion à J. F. W. Des Barres, qui était sous les ordres de l’Amirauté britannique lors qu’il exécuta son relevé des côtes américaines. Qui était cette « personne de distinction » ? Nous l’ignorons, mais des hypothèses sont possibles.
Beaurain entretenait de multiples liens avec le cartographe Julien et à travers lui avec Faden et Des Barres. En réalité, Faden avait commandé la carte de Beaurain, ce à quoi répondait Julien en août 177622. En outre, il n’y avait qu’une période de quatorze mois durant laquelle Beaurain avait pu préparer sa carte, entre l’incendie de Charlestown le 17 juin 1775 (comme indiqué sur la carte de Beaurain) et la mention de la carte de Beaurain par Julien dans sa lettre à Faden le 16 août 1776. Durant cette période, un autre graveur londonien, Andrew Dury, publia un « Plan de Boston et de ses environs » le 12 mars 1776.
Andrew (ou André) Dury était un ingénieur français et un cartographe vivant à Londres. Il était associé à Julien, comme nous le voyons d’après le frontispice du catalogue de Julien23.
Deux éléments rapprochent la carte de Dury de celle de Beaurain. Tout d’abord, les positions des troupes américaines, en jaune dans la carte de Dury, sont placées au même endroit que dans la carte de Beaurain.
Dury attribuait l’information de sa carte aux observations faites sur le terrain part “Richard Williams, lieutenant à Boston — et transmis par le fils d’un gentilhomme à son père dans la ville, avec la permission duquel elle est publiée”. Ce gentilhomme peut-il être la “personne de distinction” ?
Si Beaurain avait utilisé la carte de Dury pour les positions des troupes américaines, sa propre carte aurait été publiée un peu après mars 1776, à temps pour être présentée au roi lorsque Sa Majesté commença à être prêt à envisager de soutenir la cause américaine.



Le Chevalier Jean de Beaurain, fils
Qui était le chevalier Jean de Beaurain et pourquoi a-t-il voulu créer une carte de Boston ?
Jean-Baptiste Jacques de Beaurain était né 1728. Son père, Jean de Beaurain (1696-1771)24, né à Aix-en-Issart (Pas-de-Calais), arriva à Paris en 1715 à l’âge de 19 ans pour étudier la géographie avec Pierre Moulart-Sanson, le petit-fils de l’éminent géographe et cartographe du XVIIe siècle, Nicolas Sanson. Quatre ans après, il reçut le titre de géographe du roi, sans doute pour récompenser son travail de professeur de géographie du jeune Louis XV (1710-1774). Il fut engagé comme professeur du duc de Bourgogne, père de Louis XVI25. Jean de Beaurain père était connu pour ses histoire militaires qui contenait de nombreux plans militaires détaillés. L’Histoire Militaire de Flandre, depuis l'année 1690 jusqu'en 1694, parue à Paris en 1756, comprenait plus de 100 plans de batailles et de sièges des campagnes de Louis XIV durant la guerre de Hollande.

Beaurain fils obtint le titre de géographe du roi en 1765. En 1771, il reçut une pension annuelle de 800 livres en récompense de son « Théâtre de la derniere guerre qu'il a eu l'honneur de présenter à Sa Majesté ».
Peut-être le roi se rappelait-il les leçons de géographie données par le père de Beaurain. Beaurain fils continua le travail de son père sur l’histoire militaire : l’Histoire de la campagne de M. le Prince de Condé en Flandre en 1674 (Paris, 1774) et l’Histoire des quatre dernières campagnes du maréchal de Turenne en 1672, 1673, 1674 et 1675 (Paris, 1782) une nouvelle édition de l’édition par son père de l’Histoire militaire du duc de Luxembourg).
Le cartographe Julien, également spécialisé dans des titres d’histoire militaire26, mentionnait les cartes de Beaurain père dans son catalogue de 1763 (p. 69-71). Beaurain et Julien partageaient même un graveur, François Perrier, le protégé de Julien et son successeur (R-J Julien, « Carte de Cassel en Hesse, » 1761, et, de Beaurain, le « Plan de la ville chateau et fauxbourg d’Hanovre, presenté au roi » en 1761). Beaurain comme Julien bénéficiaient de l’accès aux cartes manuscrites des officiers militaires, dont ils usaient pour préparer leurs cartes imprimées.
Certaines parties de la carte du port de Boston sont typiques d’une carte de Beaurain, riches en décoration et dotées d’une iconographie détaillée, quelques fois expliquée :
Dans le même ordre d’idées, l’utilisation des tentes pour représenter les forces anglaises et américaines est directement empruntée au style de Beaurain père pour ses cartes des campagnes en Flandre de la fin du XVIIe siècle.
Toutefois, ces éléments d’expliquent pas pourquoi Beaurain fils aurait pu être aussi intéressé par un événement récent, alors que son œuvre jusque-là s’était concentrée sur l’histoire militaire. En 1776, il était largement endetté. Les créanciers de son père le poursuivaient depuis 1773 et en 1785 il fit finalement faillite27. Sa carte pourrait avoir été une tentative de gagner de l’argent en jouant sur un événement qui intéressait non seulement le public français mais aussi le roi et ses ministres. La gravure de la carte et le dessin du cartouche unissait Beaurain aux ministres qui préparaient activement des projets pour l’implication de la France dans la Guerre d’indépendance américaine.



Croisey, un graveur de cartes

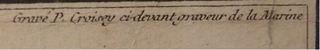
La carte de Boston de Beaurain est signé par le graveur Croisey, « ci-devant de la Marine ». On peut supposer qu’il s’agit de Jean Antoine Croisey, graveur de nombreuses cartes nautiques pour Jacques-Nicolas Bellin, l’hydrographe du Dépôt des cartes et plans de la Marine. Après la mort de Bellin en 1772, Croisey se retrouva sans emploi, d’où le « ci-devant » de sa signature. Le nouveau secrétaire d’État de la marine, Antoine-Raymond-Jean-Gabriel de Sartine, nommé par le jeune Louis XVI en 1774, engagea une réorganisation de son département ministériel. Croisey écrivite de nombreuses lettres au chef administratif du Dépôt, recherchant un place de graveur permanent ; il expliquait que Bellin lui avait toujours promis le poste — le fait que Croisey était le seul graveur permanent au Dépôt de la Marine à l’époque de la révolution prouve que ses efforts pour récupérer sa place furent couronnés de succès28.
Son talent particulier pour la gravure des cartes nautiques faisait de lui un bon choix pour graver cette carte d’un port. Croisey avait gravé des cartes pour les assistants de Julien, Perrier et Verrier.29
Le cartouche
L’élément le plus significatif de la carte de Beaurain est le cartouche30. Le discours puissant du cartouche commence avec le titre de la carte, sa dédicace et l’auteur, écrit en trompe l'oeil sur un vêtement drapé suspendu à des arbres originaires d’Amérique du Nord. Le palmier, quoique absent du Massachusetts, constituait un symbole constant du Nouveau Monde. À droite, un soldat colon américain portait le drapeau du Massachusetts de sa main droite et le plantait énergiquement dans le sol. Sur le drapeau se trouvait le symbole du Massachusetts : le pin blanc, originaire d’Amérique du Nord, un matériau abondant pour le bois des navires, sa hauteur étant particulièrement adaptée pour les mâts et sa résine très étanche dans l’eau.
En haut de la hampe du drapeau, se trouve le bonnet de la liberté, le pilleus, antique symbole de la liberté porté par les esclaves affranchis à Rome. L’un de ses emplois les plus célèbres au cours de l’Antiquité avait été la frappe de monnaies par Brutus pour célébrer l’assassinat de César.
Sur la gauche, le colon pointe un poignard vers un soldat anglais qui tente de lui arracher le drapeau du Massachusetts. Le soldat anglais porte son propre drapeau figurant le lion rampant anglais. À leurs pieds, les faisceaux, botte de verges attachées autour d’une hache, l’antique symbole de l’autorité de Rome et du Sénat Romain. L’autorité du gouvernement est au centre du conflit entre les colonies et la métropole.
Sur la gauche, regardant le duel, se tient un indigène américain avec une expression d’horreur sur le visage. Ses pensées sont exprimées dans une citation latine qui va de l’arc qu’il tient dans la main gauche jusqu’à son bouclier sur l’arbre derrière lui : « QUO SCELESTI RUITIS ? ». Le noble sauvage a choisi le premier vers de l’Epode VII du poète romain Horace pour exprimer ses pensées sur la guerre civile de Boston.




Le poème écrit par Quintus Horatius Flaccus traite aussi d’une guerre civile à Rome au premier siècle avant Jésus Christ. Le chaos suivit l’assassinat de César en 44 avant Jsésu-Christ. Sa dictature avait temporairement mis fin à presque un siècle de conflit civil, mais sa mort relança la guerre civile entre les factions dirigées par l’ancien ami de César, Marc-Antoine, et son petit-neveu et successeur, Octave. Horace exprimait dans son poème sa consternation devant ce conflit renaissant.
Revenons au latin :
Quintus Horatius Flaccus, Epode VII
Quo quo scelesti ruitis? aut cur dexteris
aptantur enses conditi?
parumne campis atque Neptuno super
fusum est Latini sanguinis?
non ut superbas invidae Carthaginis
Romanus arces ureret
intactus aut Britannus ut descenderet
Sacra catenatus Via,
sed ut secundum vota Parthorum sua
urbs haec periret dextera,
neque hic lupis mos nec fuit leonibus,
numquam nisi in dispar feris.
furorne caecus an rapit vis acrior
an culpa? Responsum date!
tacent et ora pallor albus inficit
mentesque perculsae stupent.
sic est: acerba fata Romanos agunt
scelusque fraternae necis,
ut immerentis fluxit in terram Remi
sacer nepotibus cruor.
En français (traduction de Léon Herrmann, Bruxelles : Latomus, 1953)
Où, où donc vous ruez-vous, criminels, ou pourquoi
adaptez-vous à vos dextres les glaives déchaînés?
Y a-t-il donc eu trop peu de sang latin répandu dans les plaines
et sur l’empire de Neptune, ces temps derniers ?
et cela non pour que le Romain brûle les orgueilleuses
citadelles de l’envieuse Carthage
ou pour que le Breton encore insoumis descende,
enchaîné, la Voie Sacrée,
mais pour que, selon les vœux des Parthes, cette ville
périsse de sa propre main !
Ni les loups ni les lions n’ont jamais eu de telles mœurs
et ils ne sont cruels que pour les fauves d’autres races.
Est-ce que vous êtes la proie d’une aveugle folie, d’une
force majeure ou d’une faute ? Donnez une réponse.
Ils se taisent et une pâleur livide blêmit leurs visages
et leurs esprits sont frappés de stupeur.
Il en est donc ainsi: d’amers destins poursuivent les Romains
ainsi que le crime du fratricide,
depuis que la terre fut arrosée du sang de l’innocent Rémus,
sang fatal pour sa postérité !
Plusieurs éléments de l’Epode trouvent un écho dans la scène du cartouche et dans la carte :
• « les glaives déchainés » (enses conditi), brandis par le colon, une arme de guerre remise au fourreau depuis la fin de la guerre de Sept Ans.

• « de sang latin répandu dans les plaines et sur l’empire de Neptune » (parumne…campis atque Neptuno fusum est Latini sanguinis): la carte montre à la fois la terre et la mer, et la rame et l’ancre au bas du cartouche évoquent davantage encore les activités maritimes.

• Le sang a été répandu de sorte que « le Romain brûle les orgueilleuses citadelles de l’envieuse Carthage » (superbas invidae Carthaginis arces) exactement comme les Anglais ont brûlé Charlestown.

• Le sang a été répandu de sorte que « le Breton encore insoumis descende, enchaîné » (intactus…Britannatus…catenatus) : les colons, victorieux durant la guerre de Sept ans, sont-ils désormais enchaînés par leurs maîtres en Angleterre.
• Ce n’est pas l’habitude de « Ni les loups ni les lions » (neque hic lupis mos nec fuit leonibus): le lion sur le drapeau du soldat anglais :

• « une pâleur livide blêmit … leurs esprits sont frappés de stupeur » (pallor albus …menses perculsae stupent): chaque visage montre la « stupeur », avec leurs bouches bées.
• « le crime du fratricide » (scelusque fraternae necis) dresse un parallèle entre Romains et Anglais dans la mesure où ils se combattent entre eux.
• « les voeux des Parthes » (vota Parthorum sua urbs haec periret dextera): l’autodestruction de Rome ne profite qu’à son ennemi, les Parthes ; à qui profite la guerre civile anglaise ? À leur ennemi, les Français.
Jules César avait été assassiné au moment de partir pour l’Orient afin de combattre les Parthes. Les Parthes, représentant une menace expansionniste, était un souci permanent des Romains. En effet, après la mort de César et de ses trois assassins (bataille de Philippes, 42 avant Jésus-Christ), les Parthes profitèrent des troubles civils à Rome pour attaquer la frontière orientale31.
En outre « les vœux des Parthes » étaient de voir leurs ennemis défaits et détruits. Horace évoque le fratricide de Rémus des mains de Romulus ; Beaurain nous montre le fratricide des colons par leurs frères anglais.
Les mots d’Horace sortent de l’arc de l’indien, mais celui-ci ne participe pas au conflit; au contraire, il est observateur et commentateur. Mais durant la guerre de Sept Ans, les indigènes américains jouèrent un rôle tellement décisif par leurs alliances avec les Anglais et les Français que la guerre fut parfois appelée la guerre français et indienne. L’indien dans le cartouche de Beaurain exprime l’horreur du poète antique devant la guerre civile, mais il pourrait aussi jouer le personnage du Parthe: encourageant ses anciens alliés les Français à profiter du moment où les Anglais pourraient facilement perdre leur empire.
Dédicace et présentation au roi
Le titre du cartouche nous explique que la carte a été présentée au roi. En 1776, Louis XVI était un jeune homme, âgé de seulement vingt-deux ans, et occupait le trône depuis à peu près deux ans (mai 1774). Comme son grand-père Louis XV, il aimait la géographie, l’histoire, les sciences et les cartes. Sous la houlette du premier géographe du roi, Philippe Buache, le jeune Louis-Auguste avait effectué le relevé de la forêt de Compiègne, avait cartographié le domaine de Versailles à l’âge de quinze ans et même présenté sa propre carte de l’Italie à l’Académie des sciences à seize ans.32
Il aimait aussi l’anglais, la langue, sa littérature, son histoire. Lorsque David Hume visita la cour de France en 1762, le dauphin âgé de neuf ans apprécia son History of England et le remercia pour cet excellent travail. Devenu roi, il souscrivit au Spectator afin de se tenir au courant de la vie et de la politique anglaises et de suivre les débats du Parlement anglais33. Sa correspondance avec le secrétaire d’État des affaires étrangères Vergennes révèle qu’il suivait étroitement les événements d’Amérique du Nord et comprenait les enjeux de chaque bataille34. Il a dû parfaitement savoir comment lire la carte de Beaurain et en comprendre les sous-entendus.
Mais la citation d’Horace a-t-elle attiré son attention? Son apprentissage du latin avait été confié à Claude François Lysarde, abbé de Radonvilliers, qui estimait que les cours de langues nécessitaient une complète immersion. Un contact direct avec le maximum d’oeuvres en langue étrangère devait précéder l’apprentissage de la grammaire. Je ne sais pas si les oeuvres d’Horace appartenaient à la liste d’ouvrages à lire par le dauphin (Tacite était son auteur favori), mais il est difficile d’imaginer qu’il n’ait pas été familier avec les poèmes car ils appartenaient à la culture commune. Une édition d’Horace préparée pour l’usage du dauphin à la fin du XVIIe siècle par le cardinal Desprez était assez bien considérée pour faire l’objet d’une réédition à Londres en 1694; elle contient l’Epode VII, largement annotée et avec un apparat critique35.
La carte, son cartouche et son évocation d’Horace révèlent le soutien croissant que les colons trouvaient à la cour de France. Alors qu’ils ressentaient toujours de manière cuisante la perte du Canada, les Français commençaient lentement à voir dans la crise de plus en plus profonde des colonies anglaises l’occasion de priver l’Angleterre de son pouvoir en Europe. Durant la majeure partie de l’année 1775, l’auteur dramatique et publiciste Caron de Beaumarchais avait sollicité le secrétaire d’État des affaires étrangères, le comte de Vergennes, et le roi pour apporter de l’aide aux Américains rebelles. Au départ hésitant à se mêler des affaires intérieures de l’État voisin, en particulier en poussant à l’insurrection contre un monarque homologue, le roi se laissa finalement persuader. Le 2 mai 1776, le secrétaire d’État des affaires étrangères Vergennes soumis au roi l’autorisation d’engager un million de livres « pour le service des colonies anglaises »36. Le roi de France écrivit à son cousin Charles III d’Espagne le 19 juin 1776 : « Je crois que le temps est à présent venu de concentrer toutes nos forces et de prendre les mesures les plus appropriées pour humilier cette puissance [l’Angleterre] qui est notre ennemi national et la rivale de notre maison [les Bourbons] »37.
À la fin de l’année 1776, des envoyés du congrès continental américain, Silas Deane, Benjamin Franklin, et Arthur Lee, étaient déjà arrivés à Paris afin de rechercher une intervention et une aide françaises plus importantes dans leur lutte contre leurs frères anglais. Leur négociation aboutit au traité d’amitié et de commerce signé en février 1778, à la suite duquel des troupes et des navires français partirent pour l’Amérique du Nord afin d’aider les colons pour porter le coup de grâce aux Anglais à Yorktown en 1781, ce qui mit un terme à la guerre d’Indépendance américaine.
Conclusion
La carte du chevalier Jean de Beaurain du port de Boston n’est pas une simple copie d’une carte anglaise, reproduite pour un public français dans un format réduit. En accentuant la force des Américains et la vulnérabilité des Anglais, la carte devenait un instrument de propagande. Elle présentait les forces anglaises comme inférieures en nombre et entourées par des troupes américaines hostiles mais très bien organisées. Le texte du cartouche rappelait au lecteur que le conflit dans le Massachusetts était une guerre civile dont pourrait bénéficier l’ennemi de l’Angleterre. Beaurain avait transformé ses sources anglaises en un appel à la défaite de l’Angleterre. La carte offrait ainsi un résumé saisissant des raisons que la France avait d’entrer en révolution.


